Sur la scène des Grands Hommes
Le dix-neuvième siècle français, à la recherche de grands exemples, de modèles de courage et de romantisme chevaleresque s’est emparé des vies de personnages historiques pour les porter à la scène avec force lyrisme. Victor Hugo est le représentant le plus parfait de ces auteurs dramatiques férus d’histoire et dont les œuvres biographiques servaient un propos d’intellectuel et, bien sûr, d’homme politique. Car la biographie est toujours prétexte. À littérature, dialectique, prise de position politique, dénonciation, flatterie, ou mise en perspective de l’actualité… La vie des hommes illustres est un genre littéraire, théâtral ou non, qui transmet les éclats spécifiques de la lumière d’un présent, au travers du calque opacifiant d’un retour en arrière.
Le vingtième siècle eut tôt fait de rompre avec cette tradition, préférant refondre les mythes dans le chaudron de son époque, se saisir de faits contemporains et développer des personnages de fiction éventuellement forgés sur des modèles réels. Les exceptions existent, certes, mais combien marginales ! Or, il est à croire que le vent change et que l’exercice dans son habit théâtral trouve de nouveau une ère qui l’agrée. Qu’en est-il alors du récit biographique lui-même ? Que l’on tente l’intrépide retour à la pièce historique en costumes ; que l’on se serve d’une vie illustre comme d’un contrepoint, en un dialogue comparatif ; ou que l’on travaille à la distanciation d’avec le biographique, les choix littéraires et dramatiques ne sont pas innocents. Il n’en reste pas moins qu’à travers la figure glorieuse dont on évoque la vie et les combats, ce n’est jamais qu’un soi qui transpire, fût-il collectif.
Lise Facchin
Rendez-vous manqué avec Pétrarque
Les « Cinq entretiens avec Pétrarque » de l’érudit André Ughetto sont un peu trop brouillons pour une biographie et un peu trop statiques pour une pièce de théâtre.
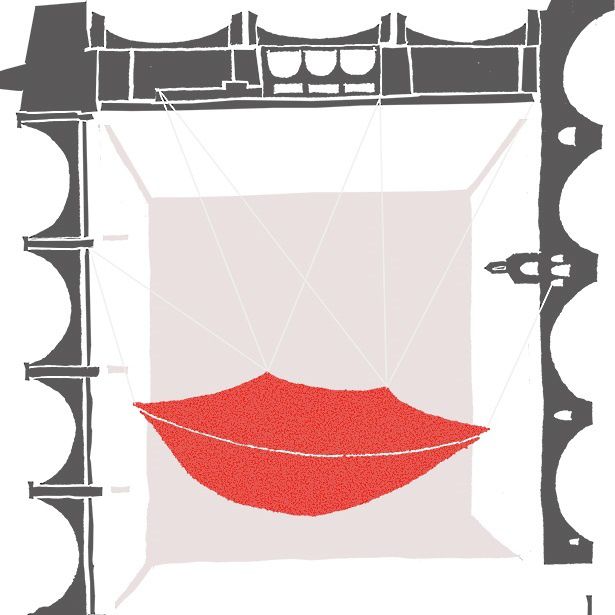
« Cinq entretiens avec Pétrarque » | © Frédéric Chaume
Du poète qui, à la fin du xive siècle, inventa l’italien comme langue savante et littéraire et lança l’humanisme, on ne sait pas grand-chose. Son art est difficile d’accès, poésie venue du fond des âges et peu ou mal traduite. Je me réjouissais donc, moi qui ignore quasiment tout de Pétrarque, d’avoir une occasion de me coucher moins bête. D’ailleurs, la forme même de la pièce laissait augurer du meilleur : cinq entretiens permettant d’aborder divers aspects de l’existence du grand homme en cassant le fil continu de la biographie : quelle bonne idée ! Il y a l’homme privé, dialoguant avec son frère, sa fille et son gendre ; l’ami rencontrant l’évêque de Cavaillon ; l’homme politique devisant avec le roi de Naples, le pape, l’empereur ou le tribun populaire romain Cola di Rienzo ; le poète parlant de confrère à confrère avec Boccace et, bien sûr, l’amoureux de Laure, femme chantée une vie durant et qui apparaît en personne à la dernière page du texte.
Digérer l’érudition
Qu’on ne s’y trompe pas, j’ai une grande tendresse pour les érudits, et ce n’est pas de gaieté de cœur que je vais donner la fessée à celui-ci. Quiconque aime le rituel de la recherche dans des archives, que ce soit comme croyant ou comme pratiquant, comprendra immédiatement à quel travail de titan s’est consacré André Ughetto pour rassembler tant de documents : poèmes dont il livre une nouvelle traduction, correspondance personnelle et officielle, bibliographie savante. À cette dose-là, c’est même de l’apostolat. Mais quiconque s’intéresse à l’érudition historique sait aussi que le difficile, dans l’affaire, est de la rendre digeste. J’emploie à dessein la métaphore gastrique puisqu’on parle ici des humanistes dont « l’innutrition » était une méthode-clé pour nourrir la langue dite vulgaire de leur pays, en faisant miel de tout ce qui pouvait être butiné dans les fleurs du langage. Faire œuvre d’historien, donc, c’est digérer l’érudition, la mâcher, la manduquer, la ruminer – comme vous voudrez – pour pouvoir ensuite donner au lecteur une becquée assimilable.
Quand le récit devient récitation
L’auteur aurait pu choisir d’écrire un livre d’histoire. C’est d’ailleurs parfois ce qu’on a l’impression de lire, comme dans le passage où le pape jette négligemment au détour d’une tirade de dix‑huit lignes, comme si c’étaient de ces banalités qu’on case tous les jours dans la conversation : « Si le Comtat Venaissin est depuis assez longtemps une terre pontificale, nous venons d’acheter depuis trop peu de temps Avignon à la reine Jeanne de Naples pour que nous ne profitions pas quelques années de ce nouveau bien, n’est-ce pas ? Ne serait-ce que pour déjouer les appétits sous-entendus au royaume de France voisin. » (1). Comme dans certains manuels d’histoire, on a souvent besoin de relire trois fois les phrases pour y voir clair dans le contexte historico-politique évoqué. Mais alors ce qui nuit à la clarté du propos historique, c’est précisément ce parti pris de théâtre et de rupture avec le fil chronologique. De ce fait, tout devient plus compliqué, chaque personnage entrant souffrant d’être présenté lourdement. Ainsi, nous disent le récitant et les didascalies : « Cola di Rienzo avait échoué dans sa révolution “romaine” de 1347 ; au cours de l’été 1352, il devint le plus illustre captif du palais des Papes en Avignon. (Cola s’assied au centre de la scène.) Il avait essayé auparavant de convaincre l’empereur Charles IV, résidant à Prague, de le désigner comme son représentant à Rome. C’était en 1350, l’année même de son jubilée. (Charles IV prend place sur son trône dès que le texte le nomme.) L’empereur le jeta pendant un an en prison, mais ne sachant qu’en faire, le livra au pape Clément VI (Clément s’assied sur le trône pontifical.) » (2). Ouf ! Un tantinet étouffe-chrétien, n’est-ce pas ?
Trôner n’est pas jouer
Le dramaturge s’épuise à comprimer trop de notions complexes en si peu de mots. On a l’impression que, suant sang et eau pour exprimer tant de données évènementielles, il a oublié l’objectif qu’il s’était fixé au début : « théâtre » (c’est écrit dessus, la couverture faisant foi). Quelle déception ! Tous ces grands hommes convoqués à la fiesta, pour se retrouver confinés à s’asseoir, se lever, parler sans bouger, se rasseoir, tenir en main « une plume d’oie pour signifier un échange de lettres » (3). Je ne dis pas qu’il faille toujours se mettre les plumes n’importe où pour que le théâtre devienne cet art du mouvement qu’il ne devrait jamais cesser d’être. Mais de là à penser que marcher de cour à jardin et de jardin à cour et trôner pour signifier qu’on est roi suffit à faire théâtre, c’est un peu court, jeune homme. Ce qui est dommage avec cette œuvre qui reste sur l’estomac, c’est que j’en reviens au seul cliché que je connaissais sur Pétrarque avant et qui sonne méchamment juste après, à savoir les vacheries de Joachim Du Bellay résumées dans son poème Contre les pétrarquistes :
« J’ai oublié l’art de pétrarquiser,
Je veux d’amour franchement deviser,
Sans vous flatter et sans me déguiser. » (4).
La pièce de théâtre qui, rhabillant Pétrarque d’un manteau de pourpre, serait un joli « contre du Bellay », reste à écrire. ¶
Élisabeth Hennebert / Frédéric Chaume
(1) Cinq entretiens avec Pétrarque, d’André Ughetto, éditions de l’Amandier, Paris, 2013, p. 58.
(2) Ibidem, p. 52-53.
(3) Ibidem, p. 60.
(4) Contre les pétrarquistes de Joachim Du Bellay, in Lagarde et Michard, XVIe siècle, Paris, Bordas, 1970, p. 101.
Cinq entretiens avec Pétrarque, d’André Ughetto
Éditions de l’Amandier, I.S.B.N. 978-2-35516-220-6, 2013, 76 pages
13 €
http://www.editionsamandier.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=370
La pièce a été créée en Vaucluse pendant l’été 2011.
Mohamed Ali, c’est moi
La pièce de Dieudonné Niangouna, « M’appelle Mohamed Ali », mêle ingénieusement biographie, considérations esthétiques et controverse historico-politique. Peu s’en faut cependant que le mécanisme de la révolte parcourant le texte ne tourne tout à fait à vide.

« M’appelle Mohamed Ali » | © Oscar Viguier
Ce monologue à deux voix, perpétuellement scandé par les didascalies « Jouant » / « Arrêtant de jouer », ne laisse pas le spectateur en repos. Tout comme le boxeur se maintient constamment en mouvement par de petits sauts agiles, le comédien et destinataire de la pièce, Étienne Minoungou, est amené à passer sans cesse de son statut réel à celui de personnage. C’est que le premier à prendre la parole, « Étienne », n’a pas l’intention de se faire l’interprète de Mohamed Ali, mais plutôt de permettre à cette grande figure défunte de s’exprimer en lui (2). Il s’agit bien en effet d’avouer que l’on joue, en désignant du doigt le protagoniste dont on a temporairement revêtu le masque. Aussi, le tout premier adversaire du combat mené par cette double voix pourrait-il bien être la simplicité formelle. On s’entendra même affirmer que « la boxe est la controverse des logiques, comme le théâtre » (3). Il est vrai, en effet, que la distanciation peut faire bon ménage avec l’intime. Mais cette option semble ici suscitée par une certaine forme de défiance vis-à-vis du spectateur…
De la confession à l’uppercut, et retour.
Dieudonné Niangouna aime à raconter qu’il est arrivé au théâtre à l’occasion d’une « gifle », produite par la lecture du célèbre écrivain congolais Sony Labou Tansy. En Afrique, dit-il, tout nouveau-né est gentiment claqué par ses parents, en signe d’éveil à la vie. Ce rite affectueux et brutal pourrait aisément représenter le type de rapport que semble entretenir l’auteur avec le spectateur de sa pièce. « Dites jamais que vous êtes venu passer une bonne soirée. Je ne suis pas votre gendre. Je ne vous dois absolument rien. Y a rien entre nous. » (4), assène ainsi Étienne Minoungou dans l’une de ses répliques. Pas de trompeuse démagogie envers le public, donc. Il s’agit plutôt de remonter au plus profond de soi pour y retrouver l’acuité des plus grandes peines, et les projeter à la face du public. La trajectoire adoptée conduit d’ailleurs le comédien à toucher le point le plus critique de la vie de Mohamed Ali : son procès pour refus d’incorporation dans l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Étienne Minoungou de confier, en effet : « Le fond de l’abîme, je l’ai moi aussi connu », avant d’aborder les tréfonds de sa propre intimité. La lutte politique autant que sportive est par-là assimilée à celle de l’acteur en scène, avec un enjeu commun : reconnaître sa force sans se faire l’arme de n’importe quel combat. D’une part, Mohamed Ali s’oppose à la guerre du Vietnam (5) ; d’autre part, Étienne Minoungou se défend d’interpréter l’homme noir tel qu’il a été créé de toutes pièces par les Occidentaux : l’assassin violeur de Blanche au visage surtitré d’un « wanted », le videur de poubelles, même le jazzman, sont autant de figures qu’il s’agit de désamorcer pour découvrir la vraie face des Africains et de leur culture.
Pour une nouvelle forme de théâtre physique ?
À l’instar du Mohamed Ali activiste, qui rédigeait parfois des poèmes prévoyant en combien de coups il vaincrait son prochain adversaire, cette pièce croise lutte sportive et revendication politique sans se priver des possibilités offertes par l’art et la poésie. L’entreprise n’est pas si simple, et le mot d’ordre est fort de son instabilité : « Danse et ne t’installe pas en dansant. Change, modifie, casse ! / faut jamais devenir une simplicité à définir pour l’autre. Un enjeu parfait à comprendre par l’autre. “Danser”. Insaisissable, c’est l’art de ne pas te laisser accaparer » (6). Première condition à ce théâtre physique : le mouvement permanent, celui de la parole qui entraîne le corps, et celui de la pensée. Car il est question de lutter contre des préjugés et autres idées fixes. La fameuse formule de Dieudonné Niangouna si souvent reprise par ses intervieweurs, « Boxer la situation » (7), est, bien sûr, le fruit de cette démarche. Son monologue se scinde par ailleurs en plusieurs voix qui se recoupent, se contredisent, provoquent le spectateur, avant de lui susurrer à l’oreille que « cogner est un acte salutaire ». Le Noir, est-il affirmé, n’a pas encore donné « sa version des faits » (8). En le faisant, il accomplirait une sorte de métamorphose émancipatrice : « Je ne joue pas, je saigne. J’enseigne. Je fais saigner, je n’ai pas le choix, le monde est un coup de poing. […] On n’aura plus le même visage après avoir raconté son histoire ».
Sur le ring, mais avec qui ?
La lutte est périlleuse, et la mise en parallèle de la situation du comédien dans toute sa fragilité, avec la force vengeresse, presque surhumaine du boxeur, s’avère marquante. Sans doute aurait-elle pu être plus poussée, plus poignante encore, creusant même davantage la subversion du rapport scène-salle qu’elle a amorcée, pour rendre la pièce d’autant plus actuelle.
Le combat mené par Mohamed Ali en son temps est indéniablement important. Mais la parole de l’acteur qui s’y juxtapose reste malheureusement axée sur la forme. En ressort une sorte d’esthétique de l’intranquillité qui possède bien sûr son intérêt. Cependant, malmener le public est une démarche défendable à condition que le fond du discours soit fort. Et si le ton de révolte prend tout son sens dans le texte au travers du personnage fictif, il ne semble se heurter véritablement à aucun adversaire en s’incarnant dans la figure d’« Étienne ». C’est comme si le propos politique clamé haut et fort sous le nom de Mohamed Ali ne s’assumait plus, ou ne trouvait pas aujourd’hui d’autre écho que formel. ¶
Florence Verney / Oscar Viguier
(1) M’appelle Mohamed Ali, de Dieudonné Niangouna, Les Solitaires intempestifs, 2014, p. 58 : « C’est un combat au passé. Un combat qui s’est passé depuis des millénaires et que sans cesse nous jouons afin de pouvoir s’accrocher au futur ».
(2) Ibidem, p. 30 : « Je vous parle du Mohamed Ali qui est en moi et qui ne s’est jamais exprimé à cet endroit. ».
(3) Ibidem, p. 47.
(4) Ibidem, p. 39.
(5) Ibidem, p. 40 : « Aucun Vietcong ne m’a jamais traité de sale nègre ».
(6) Ibidem, p. 46.
(7) Ibidem, p.47 : « Il faut boxer dans l’extrême misère, dans le ghetto, dans les townships, dans les favelas, dans la pauvreté parfaite du tiers-monde, il faut boxer ! Boxer ! Boxer la situation. ».
(8) Ibidem, p. 22.
M’appelle Mohamed Ali, de Dieudonné Niangouna
Les Solitaires intempestifs, 2014
64 pages, 28 €
http://www.solitairesintempestifs.com/livres/511-mappelle-mohamed-ali-9782846814140.html
Entretien avec Étienne Minoungou :
http://www.theatre-video.net/video/Entretien-avec-Etienne-Minoungou-pour-M-Appelle-Mohamed-Ali
Bel hommage à la « Beat Generation »
Le texte de Fabrice Melquiot est très ludique. Des listes, de l’humour et de la poésie. Une lecture facile, parfois un tantinet redondante, mais toujours empreinte de la fabuleuse joie désespérée des hippies.

« Pearl » | © Vincent Croguennec
Dans un studio d’enregistrement, un groupe de rock essaie tant bien que mal d’accoucher de son prochain album : son leader, Pearl, figure féminine inspirée de Janis Joplin, travaille quand elle l’a décidé. Entre deux joints « grands comme des cathédrales » (1), elle nous parle de libération sexuelle, de mélancolie, et chante Summertime, pour l’occasion en français, habile supercherie afin d’éviter de se frotter à ce qui aurait probablement été la pâle copie d’un mythe. Nous sommes pendant quelques heures avec six artistes en pleine gloire, et nous suivons leurs tribulations affectives et musicales. C’est juste le temps qu’il faut pour retrouver ou découvrir ce mouvement éphémère de la génération d’après guerre qui a secoué les années 1960‑1970.
Pearl est une commande du metteur en scène Paul Desveaux, qui souhaitait un double objet théâtral fait de dialogues, de monologues, mais aussi de textes à arranger en chansons qui apparaissent à la lecture comme des poèmes : « Avec Fabrice, nous ne souhaitions pas faire un biopic. […] Nous n’étions pas particulièrement intéressés par la vie pas à pas de Joplin, mais plutôt par ce qu’elle représentait de création, de génie, de contradictions, de blessures et de drôlerie » (2). Cependant, comment parler de l’œuvre d’un artiste sans évoquer sa vie ? C’est là où le texte use parfois de stéréotypes comme dans le poème « High School Corridors » (3), où l’on devine les moqueries subies lors de ses années lycée, cette carrière au sommet devenant une revanche sur l’humanité ingrate.
Une génération sur le fil du rasoir
L’œuvre de Melquiot comporte trois formes d’écriture dessinant des temporalités différentes. Le passé se concentre très pudiquement sur Pearl/Joplin dans les poèmes composés étrangement en anglais quand le reste du texte est en français. Peut-être est-ce pour demeurer fidèle au blues initialement chanté en anglais ? Le présent, indiqué par la première didascalie, s’inscrit dans le studio d’enregistrement. Le futur, enfin, apparaît dans les monologues qui portent un regard omniscient sur la situation et les évènements à venir. Ces trois dimensions temporelles offrent la possibilité de points de vue distincts et contribuent à un va-et-vient ludique qui entretient l’attention du lecteur jusqu’au bout.
Parfois, les monologues sont des listes, toujours en vingt‑sept points, comme un compte à rebours vers la vingt-septième et dernière année de vie de Pearl/Joplin. Une épée de Damoclès qui procure à Pearl son agréable rythme soutenu. Ces listes arrivent de manière régulière et donnent à l’œuvre un style presque documentaire avec des repères chronologiques comme la guerre du Vietnam, les émeutes raciales aux États-Unis, ou encore les films cultes produits entre 1965 et 1970. En outre, de nombreuses citations de Kerouac ajoutent un peu de sensibilité à cette énumération qui, seule, n’aurait été qu’informative et dramatiquement assez pauvre.
Si au départ ces changements de style sont déroutants, ils confèrent ensuite au texte une qualité qui témoigne de la recherche de liberté de ses protagonistes. Le personnage de Pearl/Joplin déclare être née « vaincue et déglinguée » (4) et que « Le génie, c’est la blessure la plus profonde » (5). Ces mots illustrent de façon assez redondante la grande détresse de la chanteuse qui exorcise ses démons avec talent par la chanson, mais aussi par la drogue et le sexe. Ainsi, pour accepter la tragédie de son histoire, Melquiot décide de faire parler parfois crûment son héroïne : « Et à part ça est-ce qu’on va réussir à baiser avant la fin de la journée ? Merde, on est des mammifères » (6). On en rira à coup sûr.
Pearl/Janis : le cul entre deux chaises
Au travers de la figure de Janis Joplin, Melquiot rend hommage à la Beat Generation avec tout ce qu’elle a véhiculé d’espoir et d’indépendance. Le choix de ne pas raconter l’existence de Joplin est également le parti pris de rédiger, en quelque sorte, un texte sans contrainte à l’image de ces utopistes aux cheveux longs. On sent alors un grand amusement dans l’écriture et spécialement dans les dialogues souvent très drôles. Malgré tout, cette volonté de ne pas traiter de la vie de la chanteuse dans ce contexte particulier de mouvement social, se ressent de manière par trop artificielle. C’est ainsi que l’on reste sur notre faim et que sitôt le livre refermé, on se ruera sur nos vieux albums pour écouter très fort sa voix puissante qui scandait l’amour et la liberté et revendiquait une place entière pour chacun dans une société trop stéréotypée. ¶
Lou Delville / Vincent Croguennec
(1) Pearl, de Fabrice Melquiot, p. 114.
(2) Extrait de la note d’intention du spectacle Pearl, m.e.s. Paul Desveaux à la Comédie de Caen en février 2014.
(3) Pearl, de Fabrice Melquiot, p. 106.
(4) Ibidem, p. 88.
(5) Ibidem, p. 89.
(6) Pearl, p. 85.
Pearl, de Fabrice Melquiot
L’Arche éditeur
52 pages, 15 €
http://www.fabricemelquiot.fr/
Lire aussi « l’Inattendu », de Fabrice Melquiot (critique), Les Déchargeurs à Paris
Lire aussi « Youri », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre Hébertot à Paris
Lire aussi « Kids », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre 13-Seine à Paris
Lire aussi « Quand j’étais Charles », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre Girasole à Avignon
Lire aussi « Wanted Petula », de Fabrique Melquiot (critique), Théâtre des Abbesses à Paris
Lire aussi « le Cabinet de curiosités », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre Nouvelle Génération à Lyon
Lire aussi « 399 secondes », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre Ouvert à Paris
Lire aussi « Tarzan Boy », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre national Bordeaux-Aquitaine à Bordeaux
Lire aussi « l’Inattendu », de Fabrice Melquiot (critique), Le Funambule à Paris
Lire aussi « Sœurs », de Fabrice Melquiot (critique), L’Élysée à Lyon
Lire aussi « En somme ! », de Marion Lévy et Fabrice Melquiot (critique), Le Montfort à Paris
Lire aussi « Ma vie de chandelle », de Fabrice Melquiot (critique), Les Déchargeurs à Paris
Lire aussi « Pollock », de Fabrice Melquiot (critique), La Criée à Marseille
Lire aussi « le Gardeur de silences », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre des Corps-Saints à Avignon
Lire aussi « Bouli Miro », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre national de Bretagne à Rennes
Lire aussi « le Diable en partage », de Fabrice Melquiot (critique), Théâtre 12 à Paris




